Psychanalyse et toxicomanie
Comment les théories psychanalytiques ont bloqué le traitement efficace des toxicomanes et contribué à la mort de milliers d'individus
Extrait du Livre Noir de la Psychanalyse (100), édition 2013.
Sommaire
L'auteur
Introduction
Les années 1970, règne de la psychanalyse
Le problème de la neutralité bienveillante
Assistance illusoire à personne en danger
La dépendance, une problématique plus personnelle que sociale
La dépendance, un problématique personnelle mais laquelle ?
Les nouvelles connaissances scientifiques en génétique et en neurologie
Ni psychanalyse ni sevrages courts mais un traitement tenant compte des facteurs neurobiologiques
Pourquoi tant de résistance aux thérapies efficaces ?
L'auteur
La drogue est un vieil ennemi que Jean-Jacques Déglon connaît depuis longtemps. En pleine période hippie, ce jeune médecin fraîchement diplômé de l’Université de Lausanne prend, sac sur le cos, le « chemin de Katmandou ». Il sillonne Népal, Inde, Afghanistan et Pakistan, à la recherche d’une réponse à l’énigme : Pourquoi les hippies européen fuient-ils vers l’Orient en quête d’un paradis improbable, pour tomber dans l’enfer de la drogue ? Après plusieurs mois aux côtés de jeunes toxicomanes, le docteur Déglon accepte, en 1970, le premier poste spécialisé en médecine des addictions à Lausanne.
Il termine ensuite sa formation à Genève, mais n’est pas satisfait : les sevrages de courte durée sont des échecs, les psychothérapies analytiques parfois dangereuses. Pourtant, il y aurait bien une autre façon de soigner, avec des traitements de substitution à la méthadone. Mais les institutions psychiatriques s’y opposent. En 1976, il s’installe en privé et développe les premières prises en charge avec la méthadone, qui connaissent un succès immédiat. Il devient ainsi un pionnier des traitements de substitution. Il crée la Fondation Phénix, sans but lucratif, qui gère actuellement à Genève, avec plus de soixante collaborateurs, cinq programmes de prises en charge médico-psychosociales pour les patient dépendants des drogues ou de l’alcool ou souffrant d’addictions comportementales (jeu pathologique, cyberdépendance, addictions au sport, au travail, ou au sexe).
Introduction
Depuis plus de trente ans, je soigne des toxicomanes. J’ai eu le privilège de participer au développement en Europe des diverses thérapies des addictions. J’ai connu des échecs, je puis exprimer librement un avis critique sur certaines des approches thérapeutiques.
Avec le recul, force est de constater que la psychanalyse, conjuguée au poids de la morale, des préjugés, des méconnaissances et des intérêts particuliers, a bloqué, de longues années durant, la mise en place de traitements efficaces des toxicomanes. En France, près de 10 000 vies auraient pu être épargnées s’il n’y avait pas eu, pendant près de vingt ans, un tel mur de résistances : chaque année, on a déploré des centaines d’overdoses mortelles parmi les héroïnomanes, sans compter, tous ceux qui ont été tués par le sida. Nous verrons qu’une grande partie de ces milliers de morts aurait pu être évitée par une politique de réduction des risques et la mise à disposition précoce de thérapies dites « de substitution ».
Il a fallu le courage d’une poignée de praticiens militants et l’engagement de quelques médecins du monde pour secouer le cocotier bien gardé de la psychanalyse où régnaient de réputés et influents psychiatres. Cette mobilisation et la nomination de nouveaux ministres de la Santé comme Bernard Kouchner ont heureusement permis à la France de rattraper en quelques années son important retard en faisant sauter le verrou de la psychanalyse et en libéralisant les approches efficaces comme les traitements médicaux avec la méthadone ou la buprénorphine (Subutex).
Issu moi-même de la culture psychanalytique, je n’ai pris conscience que progressivement des effets souvent catastrophiques de cette approche dans le traitement des toxicomanies. La pratique clinique a été mon guide : constatant les échecs répétés des cures psychanalytiques pour les toxicomanes, j’ai d’abord procédé par tâtonnements avant de m’orienter vers d’autres prises en charge que j’ai adoptées en fonction des résultats constatés. La première étape de cette évolution a été la remise en cause de la technique psychanalytique fondée sur le principe de la « neutralité bienveillante ».
Les années 1970, règne de la psychanalyse
Comme mes camarades, j’ai été très tôt imprégné par la culture psychanalytique privilégiée par les services universitaires psychiatriques. Lors de ma formation, il était plus que fortement recommandé, pour les médecins assistants en psychiatrie, de se soumettre à une psychanalyse dite « didactique ». Les contraintes de temps (4 à 5 heures par semaine pendant plusieurs années) et d’argent (l’équivalent aujourd’hui de plus de 100 euros par séance, non remboursés par les caisses maladie) me firent hésiter. Mon modeste salaire de jeune médecin me permettait difficilement un tel investissement. Sans connaissances approfondies de ce domaine, il m’était difficile d’apprécier le bénéfice de l’analyse. Je sollicitai alors l’avis de mon patron, professeur en psychiatrie, qui me répondit clairement : « Déglon, avant de pouvoir lire, il faut apprendre l’alphabet ! » Conscient de l’intérêt d’une analyse personnelle pour mieux connaître mes propres problèmes et ne pas les projeter sur me futurs patients et aussi, il faut l’avouer, par souci de faciliter de futurs engagements chez des patrons sensibles à la formation psychanalytique des candidats, j’entrepris donc, et pour cinq années, une psychanalyse.
S’il faut dresser un bilan rétroactif de cette thérapie, je dirai qu’à titre personnel et professionnel j’en ai tiré un bénéfice certain qui méritait les investissements de temps et d’argent consentis. Mais, s’il importe que les thérapeutes soient au clair avec leur propre fonctionnement psychique, cette approche ne suffit pas pour comprendre tous les troubles psychiques et encore moins les soigner. C’est particulièrement le cas pour les dépendances. Par ailleurs, cette formation psychanalytique, qui a marqué mes années de jeune psychiatre et modelé mes attitudes psychothérapeutiques, a aussi indirectement contribué aux difficultés que j’ai rencontrées les premiers temps avec les jeunes toxicomanes.
Revenir au sommaire
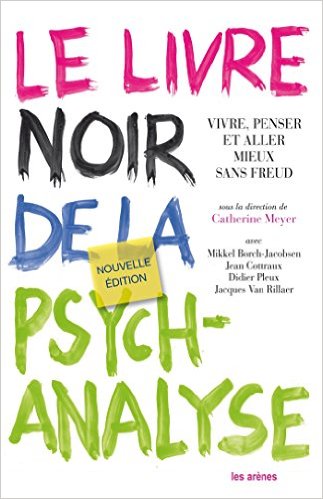
(100) Le livre noir de la psychanalyse, 2004-2010
Les arènes, 30,50 € ; disponible en poche, Editions 10-18, 11,90 €
 Fondée en 1986 par le Dr Déglon, la fondation Phenix, emploie aujourd'hui 65 personnes à Genève et est reconnue dans toute l'Europe. Site officiel de la fondation Phénix
Fondée en 1986 par le Dr Déglon, la fondation Phenix, emploie aujourd'hui 65 personnes à Genève et est reconnue dans toute l'Europe. Site officiel de la fondation PhénixLe problème de la neutralité bienveillante
La doctrine psychanalytique orthodoxe impose aux thérapeutes de maintenir une stricte « neutralité bienveillante » et d’éviter toute prise de position, tout préjugé ou jugement. Tout débordement de ce cadre, toute manifestation émotionnelle, toute prise de position directive sont considérés comme des « actings » réprouvés, de véritables erreurs professionnelles.
Je me suis longtemps imposé cette règle d’or, sans me rendre compte qu’elle n’était pas supportée par mes patients toxicomanes ou fragiles sur le plan psychiatrique et qu’elle suscitait d’importantes réactions contrecarrant le bon déroulement des traitements. Confrontés à des thérapeutes non directifs, beaucoup d’entre eux ressentent cette neutralité comme de la passivité, de la faiblesse ou un manque d’intérêt, voire d’affection. Pour certains, cela réveille douloureusement le manque paternel dont ils ont souffert. D’autres, en fonction de la fragilité de leur identité et de limites intérieures mal structurées, ont besoin d’un cadre directif. Angoissés par cette relation thérapeutique trop neutre pour eux, les toxicomanes, qui ont le plus grand besoin de sécurité, réagissent souvent par des provocations multiples, dans le but inconscient de susciter des réponses affectives quelles qu’elles soient, le pire pour eux étant l’indifférence du thérapeute. Si leur besoin d’amour et de sécurité n’est pas satisfait, l’escalade de la violence peut conduire à un besoin de « casser la baraque ». Bien des psychologues et des médecins, isolés dans leur cabinet, en ont fait la douloureuse expérience.
Ce besoin d’un cadre sécurisant, la recherche d’une présence thérapeutique active, la nécessité d’attitudes chaleureuses et de protection, comme on peut l’attendre du parent idéal, rendent difficiles, voire contre-indiquées les cures psychanalytiques orthodoxes, surtout s’il n’y a pas conjointement de traitement médical de substitution.
 Découverte en 1937, la méthadone est prescrite à grande échelle dans le monde depuis les années 60-70 pour le sevrage des opioïdes. En France, elle fut interdite jusqu'en 1995, date à laquelle l'épidémie de SIDA eut raison des résistances des toxicologues français.
Découverte en 1937, la méthadone est prescrite à grande échelle dans le monde depuis les années 60-70 pour le sevrage des opioïdes. En France, elle fut interdite jusqu'en 1995, date à laquelle l'épidémie de SIDA eut raison des résistances des toxicologues français.Assistance illusoire à personne en danger
La doctrine psychanalytique repose sur l’idée qu’il faut d’abord résoudre les problèmes inconscients, sources présumées de la toxicomanie, pour espérer secondairement réduire l’envie des drogues. La question de l’abus est négligée. L’intérêt des thérapeutes est centré sur les conflits psychiques.
Malheureusement, les toxicomanes ne peuvent attendre les années nécessaires pour mener à son terme une cure analytique car, comme le prouvent de nouvelles données scientifiques, les prises de drogue répétées perturbent de plus en plus le cerveau et aggravent la dépendance, rendant de plus en plus aléatoire le traitement. Mais, surtout, les hauts risques liés à l’héroïnomanie (overdose, sida, prison, etc.) avec leur cortège de morts persistent si les abus d’héroïne ne sont pas immédiatement enrayés.
Déjà, des études en alcoologie ont prouvé de longue date l’action toxique de l’alcool sur le cerveau et ses implications dans le développement de la dépendance et des rechutes habituelles à la moindre prise. Personne ne peut nier aujourd’hui la toxicité de l’alcool, facteur principal dans la pathologie de l’alcoolisme, maintenant mieux connue. Prendre en psychothérapie analytique les malades de l’alcool en maintenant une neutralité bienveillante à l’égard de leurs abus se révèle dangereux pour eux. Comme disait un alcoologue : « Au bout de quelques années de psychanalyse, les patients finissent par bien se connaître et comprendre leurs pulsions pour la boisson, mais ils meurent de leur cirrhose du foie. »
Souvent, pour forcer leur analyste à sortir de sa neutralité et parfois aussi parce qu’ils sont perturbés par des interprétations prématurées ou fausses qui suscitent une forte angoisse, les toxicomanes vont de plus en plus mal, et prennent de plus en plus de drogues pour calmer leur malaise. Poursuivre la psychanalyse dans ces conditions, surtout si l’analyse est seul intervenant, est dangereux. D’un point de vue médical et éthique, on ne peut pas accepter de maintenir quelqu’un dans la dépendance aux substances stupéfiantes, le temps que l’analyse résolve ses problèmes inconscients supposés à la base du problème. Le laisser continuer à se droguer, c’est l’exposer à des risques mortels avec détérioration de sa qualité de vie, alors qu’il est venu demander de l’aide. Nous avons observé plusieurs décès dans ces conditions.
En 1981, le docteur Léon Wurmser, professeur de psychiatrie à l’Université de Baltimore aux Etats-Unis, suivait des toxicomanes en thérapie analytique. Mais seulement s’ils bénéficiaient conjointement d’un traitement avec la méthadone pour supprimer les prises d’héroïne. Il estimait avec raison qu’une abstinence totale des drogues était absolument nécessaire pour espérer un quelconque résultat d’une thérapie, quelle qu’elle soit : « Aucun traitement n’aura de succès, aucune psychologie en profondeur n’aura de chance de faire apparaître avec précision les corrélations actuelles où les corrélations dynamiques profondes aussi longtemps que le patient sera sous l’influence de drogues (naturellement aussi sous l’influence de l’alcool) à l’exception de la méthadone galéniquement stable et administrée à des fins thérapeutiques. »
Dans la réalité, force est de constater que la plupart des toxicomanes arrêtent assez tôt leur thérapie analytique, de façon volontaire ou indirecte, en raison d’une hospitalisation d’urgence, d’une incarcération ou d’une overdoses. Même si cette interprétation permet la mise en place de prises en charge plus adéquates, on peut regretter la rupture du lien thérapeutique, qui doit être la priorité de chaque thérapeute. Surtout quand on sait à quel point les patients dépendants ont déjà souvent gravement souffert de ruptures affectives antérieures.
Ces risques de complications, de troubles du comportement et de décès expliquent la réticence extrême des psychiatres et surtout des psychanalystes à prendre en charge les patients toxicomanes souvent considérés à tort comme instables, dangereux, manipulateurs, trafiquants d’ordonnances et surtout mauvais payeurs. Malheureusement, sur plus de 200 psychiatres installés à Genève, seuls deux ou trois, non psychanalystes, continuent à prendre en charge des héroïnomanes et encore le plus souvent en traitements avec la méthadone. Une meilleure formation devrait pouvoir limiter tous ces préjugés et encourager le maximum de thérapeutes à prendre en charge ces patients à la fois sur le plan médico-pharmacologique et sur le plan psychothérapique.
La prudence des psychanalystes chevronnés ne doit d’ailleurs pas être étriquée mais saluée : ils connaissent les indications et les limites de leur thérapie. Certains ont été rudement échaudés par des échecs plus ou moins cuisants. Refuser d’intervenir sur un terrain qu’ils connaissent mal, par une méthode thérapeutique mal adaptée aux besoins et aux possibilités de ces patients, m’apparaît sage et médicalement éthique. C’est aussi offrir à ces derniers la possibilité de bénéficier d’une autre prise en charge avec de meilleures chances de succès.
Revenir au sommaire
 Le Professeur Leon Wurmser, d'origine suisse, a pratiqué et enseigné la psychiatrie et la psychanalyse à l'université de Baltimore, West Virginia. Il "suivait des toxicomanes en thérapie analytique, mais seulement s’ils bénéficiaient conjointement d’un traitement avec la méthadone pour supprimer les prises d’héroïne"
Le Professeur Leon Wurmser, d'origine suisse, a pratiqué et enseigné la psychiatrie et la psychanalyse à l'université de Baltimore, West Virginia. Il "suivait des toxicomanes en thérapie analytique, mais seulement s’ils bénéficiaient conjointement d’un traitement avec la méthadone pour supprimer les prises d’héroïne"La dépendance, une problématique plus personnelle que sociale
J’ai commencé ma carrière en médecine des addictions il y a trente-cinq en acceptant le premier poste de médecin assistant spécialisé dans le domaine des dépendances à l’Institution de médecine sociale et préventive de l’université de Lausanne. J’ai tout d’abord créé les premiers centres d’accueil pour toxicomanes.
J’avais en effet été frappé par les témoignages répétés des usagers de drogues expliquant leur recours aux paradis artificiels par leur incapacité à supporter le cadre social, familial et scolaire considéré comme répressif et déprimant. Peut-être en raison de leur très grande sensibilité que je liais à l'époque à une éducation non directive fréquente. Prenant au premier degré leurs plaintes, je pensais qu’il fallait ouvrir pour eux des lieux de vie privilégiés, des havres de paix sous forme de communautés thérapeutiques et de centres d’accueil ambulatoires, à l’image des « free clinics » américaines.
Mais, après un ou deux ans de prises en charge dans les centres d’accueil à Lausanne, j’ai réalisé, avec plus d’expérience et de recul, à quel point j’avais été piégé par tous ces témoignages et plaintes « sociaux » que j’avais pris au premier degré.
En fait, je me suis aperçu que la plupart de ces jeunes souffraient d’un problème psychique sous-jacent sans en être conscients : anxiété, dépression, troubles psychiatriques, hyperactivité avec difficultés d’attention et de concentration, etc. Beaucoup d’entre eux, très vulnérables, à l’identité mal définie, facilement dépressifs au moindre choc affectif, pouvaient être classés dans la catégorie des patients borderline ou « états limites ». Comme il était trop angoissant pour ces sujets de reconnaître leur fragilité ou leurs troubles psychiques à l’origine de leur malaise, ils projetaient la cause de leur souffrance sur la famille, la société, l’école, etc. C’est un mécanisme classique de défense, surtout chez les adolescents, caractérisé par le déni : « Si je souffre de mal-être avec l’envie de me droguer, je n’y suis pour rien », et la projection : « C’est la faute de mon entourage, du cadre social, etc. »
Dès lors, il m’est apparu que la réponse sociale, c’est-à-dire la création de centres de type socio-éducatif ou de communautés thérapeutiques, n’était pas la solution la plus adaptée pour la majorité des cas. Ce n’était surtout pas la plus efficace. Certes, une prise en charge institutionnelle sécurisante, sans soucis affectifs, financiers, de logement, avec des éducateurs chaleureux et des possibilités d’activités et de loisirs, a permis à une majorité des héroïnomanes placés de maintenir, le temps de leur séjour, un équilibre psychique satisfaisant avec une bonne qualité de vie et une abstinence des drogues. Même les centres du Patriarche, très critiqués à l’époque en raison de leurs aspects sectaires, ont momentanément bien convenu à des toxicomanes gravement dépendants.
Tout le problème réside dans le fait que de fréquentes causes génétiques et biologiques expliquent en partie les affections psychiques que l’on observe souvent chez les toxicomanes, particulièrement les dépressions majeures récidivantes. Cette comorbidité entraîne la souffrance psychique à la base de la toxicomanie. Malheureusement, les troubles psychiatriques sous-jacents ne sont pas guéris par le cadre institutionnel et les mesures socio-éducatives, mais provisoirement calmés en raison de l’absence de stress, de l’environnement sécurisant et de l’absence des drogues. A défaut de rester à vie en centre résidentiel, la grande majorité des toxicomanes rechutent rapidement à la sortie de l’institution protectrice. Ils sont confrontés à nouveau au stress, aux difficultés sociales, professionnelles et affectives. Ils sont tentés par l’offre d’héroïne de la part des anciens copains, ravis de ramener dans le troupeau de la défonce la brebis égarée dans l’abstinence. Pour ces raisons, la plupart d’entre eux replongent dans les drogues au prix d’une dépendance encore plus grave.
L’échec habituel des mesures socio-éducatives proposées pendant quelques années m’a découragé. J’ai pris conscience de l’importance de la fragilité et de la souffrance psychique des toxicomanes ainsi que de leurs mécanismes de défense du déni et de la projection. J’ai pris conscience qu’il fallait les considérer comme des « patients » au sens propre, c’est-à-dire comme des personnes cherchant à atténuer par les drogues leur souffrance psychique.
Dès lors, la réponse thérapeutique n’était pas de les enfermer momentanément dans des centres mais de traiter « la cause en profonde » de leurs troubles. Pour cela, il me fallait terminer ma formation psychiatrique pour apprendre la base des maladies psychiques et m’entraîner aux meilleures techniques psychothérapeutiques. C’est ainsi que j’ai passé quelques années à Genève dans le service universitaire de psychiatrie des adolescents. Les responsables, comme la plupart des cadres des institutions psychiatriques genevoises, de formation psychanalytique, privilégiaient cette approche.
J’ai été marqué par un enseignement médical scientifique de la part de patrons exigeant des faits bien établis avant de poser un diagnostic. Par exemple, lors d’un cours de pédiatrie, le professeur nous présenta un enfant en observation pour des troubles non diagnostiqués. Le pédopsychiatre qui l’avait examiné avait bien vu que, plusieurs fois durant l’entretien, le jeune patient était allé boire de l’eau au robinet. Dans son rapport, l’expert avait noté des tendances anxieuses et des besoins de compensations orales. En fait, il s’agissait d’une soif pathologique : des examens ultérieurs ont confirmé un diabète insipide à la base des troubles. Cette présentation avait pour but de nous rendre attentifs au danger de psychiatriser des symptômes sans avoir auparavant exclu toutes les causes médicales possibles.
Dans le service où je travaillais, il m’est rapidement apparu que certaines hypothèses psychanalytiques manquaient de rigueur. Je suivais un adolescent psychotique auquel j’administrais avec succès des injections retard de neuroleptiques toutes les trois semaines. Durant une séance de psychothérapie familiale, en cothérapie avec le responsable du service, le jeune patient s’était montré particulièrement agité et délirant. Tirant ensuite le bilan de la séance, mon patron m’interpréta les raisons de ce comportement pathologique en relation avec certaines affirmations des parents. « Vous ne croyez pas que c’est plutôt parce qu’il est en retard d’une semaine pour sa piqûre de neuroleptique ? » lui ai-je rétorqué. J’étais déjà partagé entre l’approche médicale biologique et la thérapie analytique.
Par la suite, médecin, chef de clinique en psychiatrie des adolescents, j’ai dirigé à Genève la première consultation ambulatoire pour toxicomanes : le Drop In. Toujours en raison de la culture psychanalytique dominante dans le service, nous favorisions avec mes collaborateurs les thérapies psychodynamiques accompagnées tout de même de la prescription d’anxiolytiques ou d’antidépresseurs.
Nous étions surtout très attentifs à respecter le sacro-saint commandement de la neutralité bienveillante.
Pour des raisons évoquées plus haut, nous avons vécu un déferlement de violence de la part de patients, qui ne supportaient pas notre bienveillante neutralité. Du reste, à cette époque, le sujet principal dans des congrès sur la toxicomanie était la violence institutionnelle. Il m’a fallu beaucoup de temps pour m’extirper des principes psychanalytiques et me déculpabiliser de pousser des « coups de gueule », d’exprimer des sentiments, d’oser des gestes d’affection et d’empathie. Ce qui était considéré par la doctrine psychanalytique orthodoxe comme des actings contre-indiqués était au contraire particulièrement thérapeutique pour les toxicomanes, des jeunes psychotiques, les borderline et de nombreux autres patients.
Il faut dire qu’à l’époque la médecine des addictions était encore à ses tout débuts et qu’aucun manuel de traitement du toxicomane n’était publié. Nous avons dû tout apprendre par nous-mêmes, sur le terrain, au prix d’expériences douloureuses, de nombreux échecs, de suicides par overdoses. Nos résultats restaient désespérément très médiocres. Nos psychothérapies, certes moins analytiques, modifiaient mal l’appétence pour l’héroïne des toxicomanes en traitement. En fin de journée, je me sentais particulièrement fatigué après de nombreuses séances où bien des patients, sous l’effet de l’héroïne, « piquant du nez » dans leur fauteuil, semblaient me dire : « Mais, docteur, c’est tellement bon, comment pouvez-vous espérer me tirer de là ? » Les psychotropes classiques prescrits non seulement avaient peu d’effets, mais souvent une action contraire, renforçant les effets sédatifs des drogues.
Provisoirement déprimé par mes échecs, fatigué des toxicomanes, je me suis alors installé en privé avec une clientèle psychiatrique habituelle.
Revenir au sommaire
La dépendance, une problématique personnelle mais laquelle ?
Jusqu’à la fin des années 1980, la cause principale des diverses addictions (héroïnomanie, alcoolisme, abus de tranquillisants, etc.) était attribuée par la plupart des psychanalystes mais aussi des psychiatres à une problématique personnelle de type psychique. Suite à un traumatisme infantile, un conflit familial, une rupture affective, un abus sexuel, des violences physiques ou morales, le jeune en souffrance serait tenté de recourir aux drogues pour calmer ses angoisses profondes avec le risque d’une dépendance toxicomaniaque.
Ce modèle de pensée s’est répandu depuis des décennies jusque dans le grand public. Il culpabilise encore de nombreux parents. Il est habituel, lors d’un premier entretien avec une famille consultant pour un problème de drogue chez un des enfants, d’entendre un père ou une mère nous demander : « Docteur, qu’avons-nous fait de mal ? Nous devons vous avouer que, quand il avait 4 ans, alors qu’il dormait bien, nous sommes sortis au cinéma et, en revenant, il pleurait à chaudes larmes. » Pour ces parents, la source de la toxicomanie de leur enfant réside dans ce choc émotionnel, cette peur de l’abandon. Pour d’autres, ce sera une dispute, un divorce, un placement en internat, etc.
Ce modèle d’une cause psychique, souvent familiale, s’est longtemps imposé pour expliquer les abus de substances, mais aussi bien d’autres problématiques comme les troubles du comportement, la délinquance, l’homosexualité, l’hyperactivité infantile avec déficit d’attention et de concentration, les troubles de l’érection, les état psychotiques, etc. D’où la mode des thérapies de famille longtemps pratiquées à large échelle jusque dans les services sociaux.
Si l’on observe n’importe quelle famille au microscope psychiatrique, il est facile de trouver des éléments permettant d’accuser l’un ou l’autre de ses membres : « Bien sûr, avec une mère comme ceci ou un père comme cela, il est normal que cet adolescent soit devenu toxicomane, délinquant ou homosexuel. »
Sans nier l’importance parfois capitale de facteurs psychosociaux, de stress ou de chocs psychique à l’origine complexe et multifactorielle des addictions, il faut rester très prudents (1) et maintenir des exigences scientifiques rigoureuses. Pour juger de la pertinence d’un facteur donné dans l’origine (ou l’étiologie) d’une affection, par exemple les pleurs de cet enfant laissé seul, il convient d’analyser un groupe suffisant de familles qui ont été dans le même cas. A coup sûr, on ne retrouvera pas une moyenne statistiquement plus élevée de toxicomanes, de délinquants, d’homosexuels ou de schizophrènes dans cette population.
C’est pourquoi j’ai pris l’habitude de déculpabiliser les parents en leur expliquant les nombreuses raisons susceptibles de contribuer au développement d’une addiction.
 (1) Ces constats rappellent ceux de Didier Pleux dans un autre domaine, l'éducation et la pédopsychiatrie : "Les croyances n'ont pas besoin de preuves. Lorsqu'il s'agit de psychanalyse, la véracité des propos n'est jamais réclamée. C'est tout l'inverse pour les autres disciplines. Je me rappelle cette critique de mon directeur d'études lorsque je préparais ma thèse et m'insurgeais quelque peu contre les différences de traitement pour doctorants. Je me plaignais qu'un seul cas suffise à valider la thèse d'un doctorant en psychopathologie (option psychanalytique) alors que j'étais astreint à des groupes témoins savamment échantillonnés pour vérifier quelques hypothèses de travail en psychologie développementale."
(1) Ces constats rappellent ceux de Didier Pleux dans un autre domaine, l'éducation et la pédopsychiatrie : "Les croyances n'ont pas besoin de preuves. Lorsqu'il s'agit de psychanalyse, la véracité des propos n'est jamais réclamée. C'est tout l'inverse pour les autres disciplines. Je me rappelle cette critique de mon directeur d'études lorsque je préparais ma thèse et m'insurgeais quelque peu contre les différences de traitement pour doctorants. Je me plaignais qu'un seul cas suffise à valider la thèse d'un doctorant en psychopathologie (option psychanalytique) alors que j'étais astreint à des groupes témoins savamment échantillonnés pour vérifier quelques hypothèses de travail en psychologie développementale."Didier Pleux, 2005-2013. "Psychanalyse et Education : la génération Dolto"
Les nouvelles connaissances scientifiques en génétique et en neurologie bousculent les certitudes thérapeutiques de la psychanalyse
Depuis toujours, on a eu tendance à expliquer les causes inconnues d’une affection par des problèmes psychiques. Lorsqu’un médecin n’arrive pas à comprendre un état clinique pathologique, après avoir épuisé les moyens de diagnostic à disposition, il adresse volontiers son patient chez un psychothérapeute. Surtout si les symptômes gênants suggèrent une origine psychique (toxicomanie, boulimie, angoisses, dépression troubles obsessionnels, phobies, impuissance, syndrome d’hyperactivité infantile, etc.).
Un exemple frappant est celui de l’impuissance. En méconnaissance des mécanismes biologiques complexes de l’érection, on a traité pendant des décennies les dysfonctions érectiles par la psychothérapie avec une majorité d’échecs. Les causes psychiques étaient chiffrées à 80 %. Des psychothérapeutes se sont efforcés, généralement en vain, d’interpréter à des générations de patients leur peur de la pénétration, la mère castratrice, le vagin denté, etc. Jusqu’au jour où, suite à une expérimentation cardio-vasculaire d’une nouvelle molécule, on a découvert l’action vasodilatatrice du Viagra@ facilitant d’érection. L’intérêt des chercheurs conjointement à de nouvelles techniques d’investigation a permis de découvrir les mécanismes très complexes des fonctions érectiles. On sait aujourd’hui que de nombreuses raisons biologiques peuvent perturber l’érection dont le diabète, le tabac et les drogues. Au point que l’on n’estime plus aujourd’hui qu’à 20 % les causes psychiques des troubles érectiles. Une prescription de Viagra@ pour faciliter la vasodilatation, associée à une psychothérapie de type cognitivo-comportementale plus performante, se révèle aujourd’hui particulièrement efficace dans ces cas. Les progrès de la science ont ainsi relégué aux oubliettes les approches psychanalytiques de l’impuissance.
La conviction profonde véhiculée par la pensée psychanalytique est donc que l’usage des drogues n’est que le symptôme d’un conflit psychique ou d’un problème affectif. Il convient ainsi de le résoudre par un traitement analytique, et, ensuite, spontanément, les prises de drogues qui n’ont plus de raison d’être doivent disparaître.
Malheureusement, la pression des pulsions obsédantes pour la drogue caractérise la toxicomanie à l’image d’un barrage en train de céder. La prédisposition génétique, la fragilité de la personnalité et la comorbidité psychiatrique, particulièrement des troubles dépressifs, ainsi que l’impact des dysfonctionnements neurobiologiques pèsent très lourdement dans cette balance toxicomaniaque. Le travail analytique seul, si bien conduit soit-il, reste très insuffisant. D’où les échecs fréquents. C’est d’autant plus dangereux que, déprimé, l’intéressé rechute plus gravement au risque d’une overdose mortelle ou d’une contamination par le virus du sida. Il faut donc contre-indiquer les prises en charge qui se soldent par des rechutes, qu’il s’agisse des approches psychanalytiques mais aussi des traitements de sevrage rapide d’un deux semaines qui visent l’abstinence totale des héroïnomanes.
Pendant longtemps, pour des raisons morales et non scientifiques, il fallait que l’héroïnomane expie sa recherche perverse de plaisir par un sevrage rapide et aussi douloureux que possible de la drogue. La théorie voulait que plus le traitement était pénible, plus faibles étaient les risques de rechute. La réalité n’a jamais démontré cette affirmation. La succession de sevrages courts, comme nous les pratiquions au début, suivis rapidement de rechutes de plus en plus graves, s’est révélée mortelle pour de nombreux toxicomanes de plus en plus déprimés par leur incapacité de maintenir une abstinence durable. Des accidents, des suicides, des overdoses, des affections foudroyantes et surtout le sida ont emporté dans la mort bon nombre de mes patients. Il m’était devenu insupportable de voir mourir tous ces jeunes auxquels je m’attachais. Et, surtout, mon sentiment d’impuissance me déprimait. C’est aussi pour cette raison que j’ai quitté mes fonctions officielles pour m’installer comme psychiatre privé.
Revenir au sommaire
Le travail analytique seul, si bien conduit soit-il, reste très insuffisant. D’où les échecs fréquents. C’est d’autant plus dangereux que, déprimé, l’intéressé rechute plus gravement au risque d’une overdose mortelle ou d’une contamination par le virus du sida.
Ni psychanalyse ni sevrages courts mais un traitement tenant compte des facteurs neurobiologiques
Peu auparavant, en 1975 j’avais eu le privilège de rencontrer le médecin directeur du programme méthadone de Porto Rico, en visite en Suisse. Je lui avais parlé du peu de succès des sevrages des héroïnomanes, de l’échec habituel des psychothérapies avec ces patients, de mon sentiment d’impuissance et de découragement. Il m’a consolé en m’informant qu’à la fin des années 1950 les Américains avaient déjà constaté l’échec systématique des traitements de sevrage rapide et des prises en charge psychothérapeutiques des héroïnomanes. Plusieurs centres spécialisés avaient été créés à grands frais pour traiter ces jeunes comme le Riverside Hospital, établissement de 141 lits doté d’une équipe de 51 psychothérapeutes. En 1956, une évaluation avait démontré que, parmi les 247 patients admis l’année précédente, 86 % avaient rechuté, 11 % étaient morts, et seulement huit patients, c’est-à-dire 3 % étaient abstinents. Après des investigations supplémentaires, il s’est avéré que les 8 sujets abstinents n’avaient jamais vraiment été dépendants des opiacés. Ils avaient été arrêtés pour trafic de stupéfiants et avaient préféré l’hospitalisation à la prison. Les autres centres spécialisés comme Lexington Hospital enregistraient les mêmes échecs répétés.
C’est pour cette raison qu’au dès 1962, les autorités américaines ont chargé les professeur Vincent Dole, spécialiste des maladies métaboliques à l’Université Rockfeller de New York, de mener des études destinées à définir de nouvelles possibilités thérapeutiques pour stabiliser durablement les héroïnomanes. En effet, malgré la prise en charge psychothérapeutique, il n’était possible de sevrer qu’une infime minorité et souvent au prix d’une qualité de vie altérée avec un pronostic défavorable.
Convaincu de l’importance de facteurs neurobiologiques dans le développement et le maintien des addictions et avant les récentes découvertes dans ce domaine, le professeur Dole testa diverses molécules qui pouvaient se fixer aux récepteurs morphiniques, sur lesquels agissent les morphines naturelles fabriquées par le cerveau. Une substance s’est révélée remarquable pour stabiliser les héroïnomanes : la méthadone. Prise par voie orale avec une durée d’action de plus de 24 heures, elle n’entraîne, à dosage adéquat, ni euphorie ni sédation chez les toxicomanes dépendants des opiacés. Des tests psychomoteurs destinés à la sélection des pilotes d’avions ont été pratiqués sur un groupe de sujets sous méthadone : ils les ont réussis mieux que les candidats pilotes car ils étaient moins stressés.
C’est ainsi que sont nés et ont été développés rapidement dans tous les Etats-Unis les traitements dits « de substitution » à la méthadone. A la fin des années 1960, plusieurs études scientifiques remarquables et des évaluations objectives ont été publiées démontrant le grand intérêt des traitements par la méthadone.
Cependant, une observation capitale a rapidement dérouté les experts. Sous méthadone, presque tous les patients pouvaient maintenir une abstinence durable des drogues, retrouver une bonne qualité de vie et sortir totalement de la délinquance, mais, à l’arrêt du traitement, même effectué lentement, avec ou sans psychothérapie et prise en charge sociale conjointe, ils rechutaient le plus souvent ou perdaient leur bon équilibre au risque d’un alcoolisme foudroyant et de la réapparition des troubles psychiatriques. Sans encore pouvoir en expliquer les raisons, les spécialistes américains ont alors évoqué un dysfonctionnement durable du système des endorphines (les morphines naturelles) ou de leurs récepteurs et proposé des traitements de longue durée qui se sont révélés plus efficaces.
Aujourd’hui, grâce aux nombreux travaux scientifiques publiés ces dernières années, ces hypothèses ont été confirmées. On a pu prouver que la prise chronique de drogues comme l’héroïne ou la cocaïne modifiait le fonctionnement du cerveau. En raison de la surexcitation répétée due en partie à la libération exagérée de la dopamine, un neuromédiateur stimulant la zone cérébrale du plaisir, ou du glutamate, un autre neuromédiateur impliqué dans les processus cognitifs (mémoire, attention, concentration, capacité à prendre des décisions, etc.), des mécanismes de défense génétiques sont induits. Des gènes normalement inactifs sont « réveillés » et donnent des ordres pour supprimer des récepteurs sur lesquels agissent ces neuromédiateurs. Pour se protéger, s’il y a trop de flèches, le cerveau en quelque sorte ôte une partie des cibles. De même, la sensibilité de ces systèmes est progressivement modifiée. (2)
Le drame, c’est que, lorsque le toxicomane arrête les drogues, son cerveau « blindé » réagit mal à un taux abaissé de neuromédiateurs sur un nombre réduit de récepteurs et souffre d’un état déficitaire de longue durée, difficile à supporter, ce qui explique les rechutes. En effet, une fois les ordres génétiques donnés, ils sont difficilement réversibles, et il faut des mois, voire des années pour rééquilibrer de dysfonctionnement neurobiologique. La psychanalyse seule est non seulement inopérante sur ces troubles, mais dangereuse par son incapacité à limiter rapidement l’abus toxique des drogues.
Il faut donc agir le plus vite possible avec des médicaments efficaces comme la méthadone ou la buprénorphine qui stabilisent ces circuits déréglés avant que les dommages soient durables, voire permanents. Nous savons aussi maintenant que l’échec systématique des sevrages courts n’est pas dû à une faiblesse de caractère des patients, mais à ces raisons médicales biologiques. Un traitement stabilisateur est donc nécessaire un temps plus ou moins long pour la plupart des héroïnomanes gravement dépendants. Une fois la plupart des problèmes psychosociaux résolus et les réflexes conditionnés pour les drogues réduits avec le temps, un sevrage très lent des médicaments « de substitution » peut s’envisager avec pour objectif le maintien de la qualité de vie acquise et de l’abstinence des stupéfiants.
Revenir au sommaire

En 1956 les Américains avaient déjà constaté l’échec systématique des traitements de sevrage rapide et des prises en charge psychothérapeutiques des héroïnomanes : à un an, sur 247 patients, à un an 86 % ont rechuté, 11 % sont décédés , et seulement 3 % sont restés abstinents. Source : Riverside Hospital, l'un des premiers grands centres de traitement de la toxicomanie.
En France il a fallu attendre 1995 et l'épidémie de Sida pour que l'on commence à s'occuper un peu plus sérieusement de la toxicomanie.

(2) Cette modification cérébrale adaptative, a été empiriquement aussi constatée pour les benzodiazépines et le circuit GABA, par le Pr Ashton, UK, dans les années 80. D'où la "méthode Ashton" de sevrage lent aux benzodiazépines, que nous préconisons avec succès, mais que la France persiste à ne pas reconnaitre, alors que seul le sevrage progressif est efficace dans le cas d'une benzodiazépine prise plus d'un mois.








