Témoignage
La domination masculine et les violences faites aux femmes en milieu totalitaire psychiatrique
A la suite d'un long séjour dans l'un des plus grands hôpitaux psychiatriques de Belgique
Février 2015
Sommaire
I. Introduction : de la difficulté du témoignage
II. Quelques mots de méthodologie
III. Définition de l’institution totalitaire
IV. Méthodes de mortification progressive d’un être humain à des fins jugées thérapeutiques
a. L’isolement et la coupure interne et externe
b. Dépouillement symbolique et réel
c. Dégradation de l’image et de l’estime de soi
d. La contamination physique et psychique par la vie en communauté en surpopulation
e. La disqualification systématique des émotions et le double bind des ateliers thérapeutiques
f. Vers la mortification totale de l’identité du patient… et le reproche de celle-ci
V. Stratégies de survie en hôpital psychiatrique et identité de groupe
a. De l’identité de groupe de reclus
b. De la violence et de la solidarité entre reclus
c. Le Système de privilèges et de punitions
VI. La violence faite aux femmes en institution totalitaire psychiatrique
a. La domination masculine chez les patients
b. La domination masculine des soignants et soignantes
VII. Conclusions et recommandations
 Forêt Hallerbos, près de Bruxelles
Forêt Hallerbos, près de Bruxelles "Le génie du mal", Liège
"Le génie du mal", Liège(1) AUSTIN J., Quand dire c'est faire, Éditions du Seuil, Paris, 1970 (Traduction par Gilles Lane de How to do things with Words: The William James Lectures delivered at Harvard University in 1955, Ed. Urmson, Oxford, 1962)
(2) Double-bind, ou double contrainte : WITTEZAELE J-J. & al., La double contrainte. L'héritage des paradoxes de Bateson, Editions De Boeck Université, Bruxelles, 2008.
Lire la définition sur Neptune
I. Introduction : de la difficulté du témoignage
Il nous semblait important d’évoquer nos difficultés à écrire les conclusions de notre observation. Bien décidée à témoigner de notre vécu et de notre analyse, le conditionnement patriarcal et institutionnel nous ont souvent conduite à postposer l’écriture de cet article. Nous la jugions inutile, voire « exagérant » une réalité pourtant véridique. Comme pour toute auteure qui dénonce des violences, la part colonisée en nous à été difficile à vaincre. A grands coups de « Tu exagères, ce n’était pas si grave » et de « Ces gens t’ont aidée, comment peux-tu dénoncer des problèmes ? », notre inconscient a tenté indéniablement de faire échouer ce projet à plusieurs reprises. Mais la volonté de témoigner est restée la plus forte. Car dire c’est faire (1), et le « dire » reste une des armes de combat performatives contre la société patriarcale, l’institution totalitaire et leurs mécanismes de violence. La difficulté intense d’oser poser les mots sur les violences vécues est un frein aux témoignages des femmes, que ce soit en milieu psychiatrique ou ailleurs. Comment dire et raconter ce qui ne se dit pas, ne se nomme pas. Et surtout, comment oser « trahir » une institution qui nous a aidée à guérir ? La loyauté à l’institution fût le frein psychologique le plus difficile à dépasser. Mais la mise en perspective sociologique et féministe de notre vécu nous ont permis de témoigner sereinement et légitimement.
Au cours de nos douze mois passés en milieu psychiatrique, de nombreuses patientes se sont confiées à nous en n’osant mettre les mots sur leur vécu douloureux au sein de l’institution. Nous les aidions à poser les mots sur leurs maux et cela les soulageait énormément. Les grandes douleurs sont muettes lorsqu’elles sont muselées par une institution qui ne permet pas de les dire, tout en forçant les patients à fréquenter des ateliers psychothérapeutiques où il leur est recommandé d’exprimer leurs ressentis. Le double bind (2) quotidien est extrêmement difficile à endurer. Au bout de quelques mois, l’esprit se brouille. Il faut arriver à faire le vide et à se recentrer pour ressentir ses propres émotions car les soignants les dénigreront. Porter la parole de ces femmes recluses nous paraît dès lors crucial. Peu osent en parler même à la sortie, de peur du jugement, de la critique et de la culpabilisation. Nous parlerons donc en leur nom pour que cessent ces violences intolérables dans un milieu censé soigner les individus.
Ce texte est le fruit d’une « participation observante » involontaire qui a duré douze mois. Nous avons ainsi passé cinq mois dans l’unité des « dépressifs », quelques semaines dans l’unité de jour, et ensuite six mois environ dans l’unité de semaine. Ce changement nous a permis de confirmer la plupart de nos observations. De fréquentes visites au pavillon « des addictions » ont également fait partie de nos recherches. Les logiques sociales décrites ici ne sont pas liées à une unité ou une autre de l’hôpital, elles sont à l’oeuvre partout à l’intérieur de l’établissement. Nous ne nommerons jamais l’institution où nous avons séjourné car nous n’en voyons pas l’utilité. Les patientes rencontrées nous ont confié vivre des choses similaires lors de toutes leurs hospitalisations en psychiatrie, peu importe l’établissement.
Nous écrivons en outre ce texte avec beaucoup d’espoir. Nous n’oublierons pas les soignant(e)s et les patient(e)qui nous ont aidée et soutenue, malgré la difficulté des contraintes institutionnelles. Nous gardons aussi l’espoir qu’en mettant des mots sur les faits souvent vécus comme normaux, les choses puissent changer pour les futures patientes reçues en institution psychiatrique. Car comme dans la violence ordinaire éducative, ces faits et cette violence sexuelle sont totalement intégrés comme normaux, ordinaires et immuables. Nous espérons que cet article permettra d’enlever ce caractère déterministe des violences sexistes en milieu psychiatrique.
II. Quelques mots de méthodologie
Il est évident que notre observation n’a pas commencé les premiers jours de notre hospitalisation. Cependant, peu après avoir repris notre état de conscience normal, nous avons eu la certitude que ces observations devaient être rendues publiques. Chercheuse, sociologue, formée aux recherches sur le terrain et à l’ethnométhodologie, les compétences et habitus professionnels ont refait surface d’eux-mêmes. Au départ, nous avons lutté contre. Ensuite, c’est devenu notre moyen de résilience pour supporter la destruction du Soi imposée par l’Institution. Dès nos premiers jours en tant que recluse, les mots d’Asiles d’Ervin Goffman (3) nous ont aidée à supporter les conditions de détention. De par le terrain imposé, nous avons employé la méthodologie ethno-sociologique afin d’organiser nos observations. D’autant plus que ce sujet avait été traité en 1968 et qu’une mise à jour des données pouvait être intéressante. Et surtout, nous pouvions apporter notre éclairage féministe aux mécaniques de l’institution.
La méthode socio-ethnologique oblige le chercheur à se placer dans la position de l’individu de la collectivité étudiée, de manière à prendre en compte ses propres implications dans la stratégie de recherche. Il faut acquérir une vue intime du monde social particulier étudié : partage du même langage commun, des mêmes activités. Le chercheur doit infiltrer le terrain, voir les choses comme le sujet étudié les voit, les pense, tout en pouvant en ressortir et voyager librement entre le vécu et l’analyse. Ce que nous avons pu faire de manière aisée. Comme le précise Coulon, « l’ethnographe doit trouver les moyens d’être là où il a besoin d’être, de voir et d’entendre ce qu’il peut, de développer la confiance entre lui et les sujets. » (4) Au vu de la situation, nous nous trouvions idéalement placée, totalement immergée par notre terrain, ayant la confiance de nombreux patients, et dès lors en mesure de comprendre les actions des acteurs sociaux observés quotidiennement. Notre formation de sociologue nous permettait de prendre la distance nécessaire pour voyager dans le terrain sans (trop) d’encombres. Internée pour dépression, nous avons été considérée comme une simple patiente par l’ensemble du personnel.
Certains jugeront peut-être qu’il s’agit d’une recherche invalide par manque d’objectivité. Bien qu’elle n’ait pas été programmée, il s’agit de d’une vraie recherche partant d’une expérience empirique (5) pour en tirer des conclusions. Nous avons en outre au maximum tenté de rester neutre concernant les observations et les conclusions tirées, bien que notre raisonnement soit biaisé, forcément, par notre appartenance à la classe des reclus et aux affects liés. Mais cette particularité comporte aussi un avantage. Pour une fois, la chercheuse n’a pas été traitée comme telle mais comme toute autre malade, et a pu donc voir au mieux et au plus proche les logiques sociales à l’oeuvre, sans fard. Ainsi, Asiles, tout comme cet article est écrit du point de vue des internés, à partir du cadre de référence qui leur est propre, comme tout livre d’ethnologie qui « rend justice à la culture étrangère en refusant de la défigurer par les indignations ou les rationalisations de l’ethnologue. » (6) Nous dégagerons donc ici, à partir d’une expérience sur le terrain, les logiques structurales qui émergent de l’institution totalitaire qu’est l’hôpital psychiatrique. Concernant nos affects, pourrions-nous même les éradiquer totalement de cette recherche, les faits de violence psychologique et physique sont présents. Nous ne les avons pas inventés car nous n’y avions même pas pensé au préalable. Viols, humiliations, insultes, isolement, il s’agit d’événements qui ont eu lieu, souvent devant plusieurs témoins. Si la souffrance morale est peu mesurable, la souffrance physique nous paraît plus objectivable et elle l’a été, à de nombreuses reprises.
Les discours concernant les soins de santé mentale et les institutions psychiatriques sont très souvent issus des médecins, psychiatres et autres soignants. Rarement du point de vue des patients. Et quand ils le sont, ils sont disqualifiés. Pourtant, ce discours est très important afin de comprendre et de mettre au jour les contraintes institutionnelles et les cadres de l’interaction entre soignants et patients. Ce type de recherche permet aussi de faire sortir du cadre « thérapeutique » des comportements définis comme liés à la maladie par les soignants, alors qu’ils sont simplement des conduites d’adaptation aux contraintes et au cadre de vie totalitaire. Le discours ethno-sociologique, n’est pas antagoniste à celui des psychiatres, il lui est complémentaire pour un meilleur soin, et surtout un meilleur respect, du patient, et surtout des patientes. Notre but n’est ainsi pas de dénoncer les violences pour nous plaindre, mais pour rendre visible l’invisible en espérant que cela puisse servir à améliorer les soins apportés, en prenant en compte la dimension sexiste des violences de l’institution.
Dans cet écrit, nous définirons en premier lieu l’institution totalitaire, expliquerons ses méthodes violentes et nous nous concentrerons ensuite sur la violence vécue entre les patients. Car la violence institutionnelle n’est que la moitié de la violence à subir en hôpital psychiatrique. L’autre moitié, et souvent la plus forte, est celle vécue au coeur-même de la microsociété des reclus. Nous précisons d’ores et déjà que l’institution totalitaire psychiatrique violente tous les patients, peu importe qu’ils soient hommes ou femmes. La souffrance des hommes hospitalisés n’est donc pas niée. Elle existe et est tout aussi inhumaine. Cependant, les femmes ont à subir des violences supplémentaires et différentes des hommes au sein de l’institution. Comme dans la société globale, la violence, le sexisme et la domination masculine y règnent en maîtres, légitimés en outre par l’institution elle-même. Le but de notre article est dès lors de souligner les violences expressément vécues par les femmes en plus des violences générales infligées à tous les reclus. La majorité des patients (environ 75 %) présents lors de notre séjour étaient de sexe féminin. D’où l’importance d’un témoignage et d’une observation à visée féministe.
Revenir au sommaire
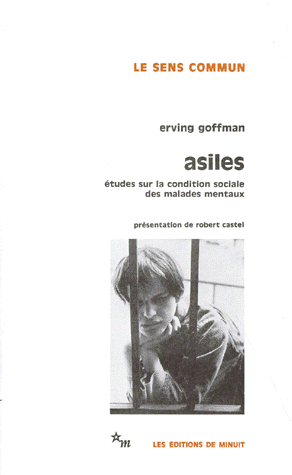 (3) GOFFMAN E., Asiles, études sur la condition sociale des malades mentaux, Editions de Minuit, Paris, 1968
(3) GOFFMAN E., Asiles, études sur la condition sociale des malades mentaux, Editions de Minuit, Paris, 1968 (4) COULON, A., L’ethnométhodologie, coll. Que Sais-je, Editions Presses Universitaires de France, Paris, 1987
(4) COULON, A., L’ethnométhodologie, coll. Que Sais-je, Editions Presses Universitaires de France, Paris, 1987(5) Empirique : basé sur des observations vérifiées, mais sans démonstration scientifique. Ndlr : A noter que la psychiatrie est la branche la plus empirique de la médecine : un résultat "empirique" y revet une connotation positive, tandis qu'en sciences exactes, le résultat "empirique" est connoté négativement.
(6) CASTEL R., in GOFFMAN E., Idem.

1855, Surrey County Asylum
 "Guérir à s'en rendre malade", Jean Robitaille, biographie de 10 ans de psychiatrie, 2009
"Guérir à s'en rendre malade", Jean Robitaille, biographie de 10 ans de psychiatrie, 2009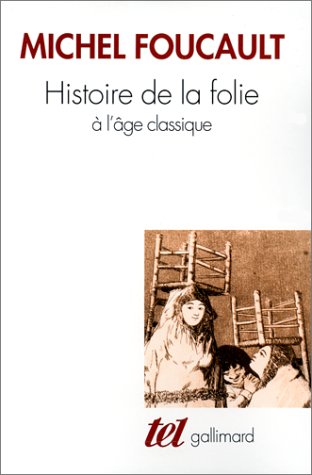
(7) FOUCAULT M., L’histoire de la folie à l’âge classique, (rééd. 1961), Editions Gallimard, Paris, 1997.
III. Définition de l’institution totalitaire
L’institution totalitaire, qu’il s’agisse d’une prison, d’un hôpital psychiatrique, ou d’un couvent « rassemble la plupart des traits structuraux des établissements spécialisés dans le gardiennage humain et le contrôle totalitaire de leur mode de vie : l’isolement par rapport au monde extérieur, la promiscuité entre reclus, la prise en charge de l’ensemble des besoins des individus par l’établissement, l’observance obligée d’un règlement qui s’immisce dans l’intimité du sujet et programme tous les détails de l’existence quotidienne, l’irréversibilité des rôles des membres du personnel et du pensionnaire, la référence constante à une idéologie consacrée comme seul critère d’appréciation de tous les aspects de la conduite.» (3) L’idéologie dominante dans un hôpital psychiatrique est celle de la guérison, jugée sur des critères propres aux soignants. A aucun moment il ne sera demandé au patient s’il se sent guéri ou quels sont les critères qui lui permettraient de juger de sa guérison.
Nous exposerons ici les méthodes de disqualification progressive à l’oeuvre envers les reclus. Car ce sont bien ces méthodes qui permettent d’expliciter les conduites des patients bien plus que leur pathologie. C’est pourquoi nous rejoignons également Goffman sur le fait que « faire la sociologie de l’hôpital, c’est restituer aux conduites des malades le sens spontané que l’interprétation psychiatrique commence par leur dérober, c’est prêter une voix au malade lui-même » (3). Le malade est ainsi toujours moins fou qu’il n’y paraît lorsqu’est explicité le vécu quotidien dans l’institution au-delà des explicitations psychanalytiques et médicales. Ce à quoi, pourtant, les soignants se refusent obstinément de soustraire. Nous y reviendrons. La reconnaissance du vécu des patients mettrait à mal le sens même de l’institution totalitaire, car elle le considérerait alors comme agent social capable de réflexion et co-constructeur de sa guérison. Ce qui est totalement interdit dans ces endroits et non-encouragé. L’individualité du patient est connotée négativement, le tournant vers sa maladie, car l’individu est le seul responsable de sa pathologie. Il faut donc le réhabiliter par l’asile « qui se veut un espace social neutralisé au sein duquel peut se réinstaurer par la discipline un ordre nouveau annulant le désordre de la folie.» (6)
Avec un minimum de sens critique, il est dès lors simple de comprendre que les patients, soumis à une mortification et à une déstructuration de leur identité et de leur vie ainsi que de leurs droits fondamentaux, « luttent avec leurs seules ressources pour survivre, sauvegarder un minimum de liberté et de dignité et glisser leur volonté de bonheur dans les failles d’une organisation qui n’est pas faite pour eux. » (6) La situation de malade place ainsi d’office le patient dans une situation de riposte aux interdictions et à sa disqualification mortifère. Soulignons dès maintenant que tous les patients, hommes et femmes, sont soumis à cette mortification de l’individu et en souffrent tous. Cependant, les femmes en souffrent encore plus par des procédés qui relèvent de la société patriarcale, à l’oeuvre dans cette institution comme partout dans la société. En effet, l’institution totalitaire s’inspire des valeurs à l’oeuvre dans la société en les durcissant, puisqu’elles sont les moyens présumés de soin contre la folie. Le fou, en effet, comme dirait Foucault (7), est quelqu’un qui a osé s’affranchir des normes et valeurs sociétales. Il est donc du devoir de l’institution psychiatrique de le remettre dans « le droit chemin ». Car le fou est dangereux pour la société puisqu’il dénonce l’inutilité profonde des ces fameuses normes.
L’institution totalitaire est donc à la fois « un modèle réduit, une épure et une caricature de la société globale ». (6) L’étudier c’est donc aussi étudier les valeurs sous-jacentes à la société dans laquelle cette structure existe. Il faut faire rentrer le Fou dans le moule social pour que plus jamais il ne puisse le remettre en question et se réinsère sans faire de vagues. Comment l’institution totalitaire psychiatrique procède-t-elle ? Via divers procédés extrêmement violents : dépersonnalisation, mortification de l’être, disqualification des discours et des ressentis, qui sont autant de méthodes dictatoriales basées sur la terreur pour faire rentrer les « fous » dans « le droit chemin de la santé mentale ». Notre analyse féministe soulignera, en plus de cette violence commune infligée aux deux sexes, la violence supplémentaire infligées aux femmes.
Revenir au sommaire

Le Lion de Waterlow
IV. Méthodes de mortification progressive d’un être humain à des fins jugées thérapeutiques
a. L’isolement et la coupure interne et externe
La disqualification de l’être humain en hôpital psychiatrique se fait via différentes phases. La première est celle de l’isolement. Coupure externe du monde, interdiction d’avoir parfois même des contacts avec les proches. Mais surtout, coupure interne entre les soignants (demeurant des humains à part entière) et les patients (devenant des reclus). Immédiatement, nous sommes placée en situation de servitude et de dépendance au personnel. Celui-ci définit l’ensemble des normes, via une abolition totale de tous les privilèges d’une liberté normalement acquise (vêtements, horaires, permissions diverses, sorties). La domination est donc énorme, tant au plan symbolique que concret. Le patient intègre vite la servitude comme sa nouvelle identité. Dès l’arrivée en hospitalisation, nous comprenons que le discours officiel sur nous-mêmes sera tenu par les soignants, pas par nous. Nous n’existons plus. La situation de pénurie dans laquelle nous nous trouvons est difficile à supporter. Dès l’arrivée, nous devons vider notre sac, donner tout : clés de voiture, médicaments, objets personnels. L’argent peut être gardé mais pas dans tous les pavillons. Nous nous retrouvons donc dans un endroit où nous dépendons entièrement du bon vouloir des soignants, avec des horaires minutés pour tout. Aucune liberté n’existe. Au départ cela ne nous choquera pas de trop car l’état émotionnel est trop difficile à supporter. Mais plus nous commencerons à prendre conscience des choses, plus cet état de servitude deviendra intolérable.
Dans cette coupure interne, nous soulignons aussi ce que nous avons appelé « l’investissement » voir le « viol » de notre sphère privée, qui devient inexistante et non-respectée. Notre vie appartient totalement à l’institution et aux soignants. Tous les endroits sont publics, les chambres, les douches, les WC y compris. Et mixtes pour ces derniers par-dessus le marché. Ce viol symbolique de l’intimité est très difficile à vivre. L’institution totalitaire brise la frontière normalement établie entre la vie privée (nos besoins primaires tels dormir ou manger), la vie professionnelle et notre vie de loisirs. Nous n’avons plus le choix de rien et le privé n’existe pas. Même les consultations avec le psychiatre se passent devant toute l’équipe, avec gloussements et moqueries tolérés, alors que certaines personnes sont seulement aide-soignantes et n’ont aucune formation en psychiatrie. Nous verrons ainsi nos propos déformés et répétés à l’envi entre soignants. Notre vie privée n’est plus à nous. Les traitements sont également imposés à tous de manière unilatérale, sans s’interroger sur les réels besoins des individus ni sur l’efficacité de cette prise en charge collective. Nous comprendrons vite que l’équipe infirmière, malgré ses dires, n’est pas là pour soigner mais pour veiller à ce que le règlement totalitaire soit respecté et dénoncer toute « sortie » hors du rang. Il nous est souvent interdit d’avoir une aspirine sur nous…les soins de base doivent être confortés par un médecin…pour un médicament librement en vente en pharmacie…que de patients avons-nous vu malades et souffrant de douleurs n’ayant même pas droit à un simple antidouleur.
Entre reclus et soignants, nous constaterons vite que le fossé est infranchissable et ne peut jamais faire l’objet d’un rapprochement sous peine de grave sanction, symbolique ou réelle. Cela arrive parfois, bien sûr car beaucoup de soignants sont très humains, mais cela sera toujours sanctionné, sous prétexte de « transfert psychologique » ( 8 ). Ainsi, notre psychologue comprenait très bien notre état de découragement face aux administrations et à la lourdeur des démarches pour notre maladie chronique (indépendant de la dépression). Mais le médecin psychiatre du pavillon (ne nous ayant jamais rencontrée !), avait déclaré que nous simulions nos difficultés au vu de notre parcours universitaire et étions juste une hystérique (9) . Pleine de courage, notre psychologue a donc outrepassé cette étiquette et a osé demandé de l’aide…Nous fûmes toutes deux sévèrement tancées…et nous n’obtinrent que des punitions sévères et violentes de la part des assistantes sociales se sentant offensées. Notre étiquette dans l’institution s’empira et nous fûmes insultée à plusieurs reprises, traitée de «menteuse, profiteuse, de cas social simulatrice, assistée qui profite du système depuis toute sa vie en institution, lâche, incapable, paresseuse… » Les mois passés en institution nous avaient heureusement permis de surmonter cette épreuve en nous dissociant totalement de ce discours. Mais cela fût difficile et nous avons vu beaucoup de patients sombrer en dépression suite à ces violences verbales injustifiées…ou essayer de se tuer.
L’isolement, dans cette logique de coupure interne et externe, est prôné comme le moyen ultime de soin. Lorsqu’un patient se « révolte » (donc ose dire ses émotions), il est immédiatement envoyé en cellule d’isolement. Au trou ou au cabanon comme nous disions entre nous. Menace suprême qui nous fut formulée régulièrement. Nous avons déployé de larges stratégies pour cependant ne pas y aller grâce en simulant la soumission. Nous avons cependant rencontré beaucoup de personnes y étant passées, pour une simple colère ou une tristesse ou encore un acte suicidaire (la logique nous échappera toujours sur ce point car en quoi isoler quelqu’un permet-il de soigner ses idées suicidaires ? Cela nous paraît davantage être une solution de facilité pour les soignants car il ne faut pas encadrer la personne). La cellule d’isolement est petite, aux murs blancs. Il y a juste un lit au milieu et une bouteille d’eau sans bouchon. Vous y êtes mis nus ou en sous-vêtements avec un tablier d’hôpital. Certains sont attachés au lit par « sécurité ». Impossible de savoir l’heure ou de savoir quand on pourra sortir. Tant que les patients crient pour s’échapper ils ne sont pas libérés. Les longues heures de souffrance des jeunes enfermés en-dessous de notre chambre en sont l’exemple. Nous ne pouvons oublier ces cris d’horreur et d’appel à l’aide…. Nous restons convaincue que l’isolement n’a jamais soigné quelqu’un. Au « mieux », il force le patient à se soumettre davantage et à se taire. L’enfermement peut durer un jour, une semaine, qui sait… surtout pas le patient.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, nous avons observé que le personnel se sent toujours (ou manifeste ou simule le fait d’être) dans son bon droit, sûr de lui tandis que les êtres reclus se sentent dépossédés de leur être, coupables (même sans avoir rien fait), et faibles, déchus de leurs droits fondamentaux. Les infirmières jouent aussi rôle de filtre de leurs discours, en allant raconter ensuite au psychiatre ce qu’elles veulent bien sur le patient. Sa parole est dénaturée en permanence. Systématiquement, nous sommes tenus dans l’ignorance des décisions qui nous concernent. Et nous n’avons nulle part où parler. Le groupe AA deviendra ainsi le seul lieu de liberté de parole sécurisé où nous avons pu nous exprimer. Les groupes thérapeutiques le sont à moitié car bien que les psychologues soient d’excellents professionnels et très à l’écoute, le patient ne sait jamais si son discours ne sera pas répété et déformé ailleurs.
En résumé, l’isolement prépare le patient à briser à jamais sa personnalité extérieure à l’institution, la définissant comme mauvaise et liée à la maladie. Certains patients ne la retrouveront pas, notamment dans leur rôle de parent. Comment en effet se sentir encore capable de quelque chose et un individu libre après avoir connu un tel isolement et une telle coupure avec les rôles sociaux anciens ?
Revenir au sommaire

Iles Féroé

Au "Pavillon Féroé" de l'HP Pierre-Janet du Havre, inauguré en 2013.
(9) Note de Neptune : l'hystérie est le nom que l'on donnait, surtout au début du 20eme siècle, à un grand nombre de "troubles" dont on affublait de préférence les femmes : étymologiquement hyster = utérus. Freud en particulier a construit une partie de sa réputation sur des "guérisons d'hystériques" - très fortement contestées aujourd'hui. Les classifications modernes parlent de "trouble somatoforme" (douleurs et affections physiques liées au mental) ainsi que de "trouble de la personnalité histrionique" (nécessité pathologique d'être admiré). Les écoles psychanalytiques encore très influentes dans les pays francophones continuent d'enseigner en université et font, comme on le voit, perdurer ce diagnostic sexiste et méprisant dans la psychiatrie institutionnelle.
 "Les portes des chambres restant en outre fermées la journée, nous n’avions même pas accès à nos affaires"
"Les portes des chambres restant en outre fermées la journée, nous n’avions même pas accès à nos affaires" « Nous vous laisserons dormir, nous ne sommes pas des monstres ». Sauf que la réponse fût inlassablement négative...
« Nous vous laisserons dormir, nous ne sommes pas des monstres ». Sauf que la réponse fût inlassablement négative...b. Dépouillement symbolique et réel
Après l’isolement, nous avons noté, tout comme le notait Goffman, le principe du dépouillement de la personnalité. Cela se fait à l’arrivée mais également durant tout le séjour. Toute possession est surveillée, confisquées à l’envi. Tout signe distinctif est prohibé. Lors de l’admission, vous subissez un interrogatoire énorme (par une simple infirmière), avec historique de votre (ancienne) vie, C.V., antécédents médicaux etc., ainsi que remise de vos effets personnels. Lorsque la personne estime que vous êtes assez « dépouillé » et présentable, vous êtes présentés aux autres patients. C’est un moment très difficile car cela signifie votre entrée réelle dans le monde des reclus et l’accueil des autres est généralement très froid. Vu leur vécu difficile, le groupe de patient est soudé et réfractaire à l’arrivée de nouvelles personnes, sauf si, comme nous le verrons par la suite, il apporte des ressources. N’ayant pas encore intégré totalement notre identité de recluse car n’ayant jamais connu cette situation, il fût difficile de nous intégrer. Les premiers jours furent un cauchemar : s’habituer au dépouillement, à la vie collective et minutée et au fait que nous ne pouvions plus rien décider de notre vie fût très éprouvant moralement. Nous découvrions chaque jour les règles, pas de téléphone portable à telles heures, pas d’ordinateur, pas de télévision, etc.
Le dépouillement passe aussi par celui du lieu de vie, ascétique. Tout est nommé au nom de l’institution : couverture, draps, oreillers, serviettes. Ils sont changés règlementairement par les patients à heure et date fixe. La personnalisation du lieu de vie est désencouragée, voir vue comme une provocation. L’amélioration du confort aussi. Ainsi, une jeune femme ayant décoré sa chambre avec goût se fit punir et rabrouer par une infirmière car « on n’est pas au Club Med ici ».
Les patients ne doivent s’attacher affectivement à rien de l’environnement. Une grande violence vécue est ainsi celle appliquée au pavillon de semaine : même en étant hospitalisé en continu, nous devions changer aléatoirement de chambre et de lit toutes les semaines. Les portes des chambres restant en outre fermées la journée, nous n’avions même pas accès à nos affaires. Impossible donc d’avoir un endroit sécurisant et accessible, même une simple armoire. Cela encourage d’ailleurs au vol d’une manière énorme puisque « rien n’est à personne »…nous nous sommes fait voler des affaires de toilette et de la nourriture à de nombreuses reprises. Sur ce fait, bizarrement, le personnel infirmier ne sanctionne pas… Les armoires peuvent fermer à clé mais il faut cependant tout sortir et reprendre chez soi pour le weekend, peu importe qu’on soit motorisé ou non, et donc laisser toutes nos affaires pendant des heures à la vue de tous…
Les linges de lit et tout le matériel sont en outre vieux, usés, troués, inconfortables, pour bien montrer la valeur que nous donne l’institution : aucune. Les heures où les douches sont accessibles ne permettent pas de se relaxer ni que tous les patients se lavent (une douche pour 18 personnes). Les chambres sont fermées à heures fixes pour ne pas pouvoir se reposer. L’individu est dépossédé de lui-même et de pouvoir répondre à ses besoins primaires : bains, lavage, nourriture (la cuisine est fermée aussi à heures fixes) et surtout repos. A nos interrogations à ce sujet, le personnel répondra qu’il faut bien fermer les chambres sinon les patients exagèrent et dorment tout le temps. Ce qui est logique vu qu’il y a peu à faire et que de toute façon la plupart sont médicamentés. Donc au lieu de dormir dans leur chambre ils dorment…dans les fauteuils. Certains rentrent même chez eux pour dormir en catimini. Pouvoir dormir le matin est un privilège très rarement accordé. A plusieurs reprises, nous avons mentionné notre problème de sommeil et besoin de repos le matin, cela fût nié par le personnel, à chaque fois, après les premières semaines d’hospitalisation. « Bien sûr, si vous en avez vraiment besoin, nous vous laisserons dormir, nous ne sommes pas des monstres ». Sauf que la réponse fût inlassablement négative. Encore faudrait-il avoir le temps de formuler une requête. En effet, le matin, nous sommes réveillés en fanfare et sans gentillesse par une des infirmières. Il faut se presser. La vie des patients leur appartient et n’est pas à eux. Un jour où nous étions vraiment mal, une infirmière nous a réveillée et s’est livrée à un interrogatoire serré sur des problématiques complexes d’emploi et d’administratif. Des réponses données dépendait notre sortie. Le patient n’existe plus comme un individu qui se réveille et à qui il faut du temps, non, il est un objet à disposition et ses besoins ne comptent pas. Le stress créé chez lui non plus.
Revenir au sommaire

c. Dégradation de l’image et de l’estime de soi
Si l’isolement et le dépouillement sont difficiles à subir, la dégradation de l’image de soi est de loin la plus éprouvante des violences reçues tout au long de ces mois. Peu après notre entrée, nous comprendrons que l’ensemble des patients sont considérés comme fous, malades et mauvais, à « rééduquer » et à « corriger » pour être réinsérés dans la bonne société et ne plus représenter un danger. Nous avons compris également que nous étions observés en permanence par le personnel dans son « bocal » (local vitré d’où les infirmières voient tout). Nous écoutions souvent les discussions du personnel en nous plaçant sur le fauteuil le plus proche. Croyant ne pas être entendue, l’équipe infirmière commentait et notait tout. La façon de parler, la façon de manger, la façon de marcher, la façon de rire…tous ces faits et gestes sont notés et jugés. Nous sommes fous et ils doivent nous réparer. Les activités sans sens se répètent, les règlements stupides et incohérents également. On nous parle comme à des enfants d’environ six ans : « Vous avez bien fait pipi ? Vous vous êtes bien lavé les mains ? Où est-ce que vous allez encore ? Mais qu’est-ce qu’ils nous font maintenant à attendre tous ? Soyez sages hein »
La palme de cette infantilisation et de la dégradation de l’image de soi revient à l’atelier cuisine obligatoire du vendredi. Nous sommes obligés d’y participer, d’en choisir le menu (qui de toute façon ne nous conviendra pas vu nos allergies alimentaires dont personne ne tient compte), d’aller faire les courses, d’acheter dans certaines boutiques onéreuses, pour ensuite se faire tancer sur nos « dépenses » extravagantes, alors que nous avons juste pris ce qui était indiqué sur la liste. Ensuite, nous sommes mis à l’oeuvre avec du matériel de fortune qui ne coupe pas, la pression est énorme et le personnel infirmier n’hésite pas à montrer son désintérêt et son mécontentement. Sur ce point les patients sont d’accord, ils n’aiment pas non plus cet atelier obligatoire et stressant au possible, mais lorsqu’ils le disent, ils se font rabrouer « on fait tout pour vous et vous n’êtes jamais contents ».
De nombreux outrages psychiques viennent renforcer cette désagrégation de l’image de soi : nous n’avons pas le droit d’aider quelqu’un qui tombe car nous sommes trop « gentils » donc « c’est normal du coup de se faire avoir dans la vie tout le temps », la thérapie psychologique est souvent remise en cause et vue comme inutile « pour des gens comme ça qui se complaisent dans leur malheur et la paresse. » Ainsi, nous avons découvert plusieurs patients en hôpital de semaine n’ayant même jamais vu la psychologue du pavillon car personne ne l’avait jugé nécessaire. Ces personnes souffraient pour la plupart de graves crises d’angoisse et nous fûmes très choquée de voir qu’on les laissait ainsi sans aucune aide. En influençant ces patients à sortir du discours du staff infirmier sur la psychologie inutile, nous avons souvent réussi à ce qu’ils soient pris enfin en charge et avec de bons résultats.
Beaucoup d’infirmières remettent aussi en cause les ateliers thérapeutiques, leur utilité, et refusent même que nous échangions entre patients sur ce que nous y apprenons. Nous fûmes ainsi une fois mise hors du pavillon car nous montrions aux patients des documents médicaux sur les effets de l’alcool, reçus au groupe sur les addictions. « Toi avec tes conneries je t’ai dit que plus jamais on ne parlait de ses ateliers entre patients, range ton barda et casse-toi au lieu de foutre le bordel». Pareil avec la documentation des AA. Nous la ramenions, le personnel infirmier la jetait. Nous la re-réamenions. Elle finissait à la poubelle. C’est devenu un jeu rituel et beaucoup de patients ont pris plaisir à faire passer des informations « interdites » avec nous. Chacun amenant à son tour un feuillet AA dans le pavillon. Cette solidarité entre patient sera évoquée plus loin, car elle seule permet de tenir en milieu hostile. Nous suivions également un atelier de vidéothérapie sur l’estime de soi. Tout haut bien sûr, une infirmière déclara « Ce n’est pas pour vous cet atelier, c’est pour les gens vraiment gros, moches, qui ne ressemblent à rien et se détestent, vous n’avez rien à faire là, vous prenez la place d’autres gens qui en ont besoin». Le fait de souligner que les patients profitent des ateliers et sont illégitimes est également très courant. Le patient est un usurpateur. Selon beaucoup d’infirmières, ils ne devraient même pas avoir accès à tout cela car ils doivent juste « payer » et être corrigés. De quoi, mystère. Ainsi, le personnel soignant se met souvent en porte à faux avec les thérapies suivies… et ne sait en fait même pas de quoi il en retourne. De notre expérience, cela vaut mieux pour la relative liberté qui y existe encore.
Les jugements à l’égard des thérapies, des idées des patients, de leur vécu, de leurs envies, sont la plupart du temps exprimés tout haut devant les autres patients et le reste du staff, pour créer de l’humiliation. Nous nous rappellerons toujours de l’infirmière entrant dans la chambre lors du réveil en claironnant à l’infirmier derrière « Faut qu’Herbigniaux bosse son estime de soi aujourd’hui de dire non à X . » Après, nous avons été nous expliquer avec ladite infirmière qui ne s’était même pas rendue compte d’avoir dit cela. Ce qui est normal vu que ce comportement d’humiliation quotidien est intégré comme étant la norme. Cette femme ayant en outre subi des violences dans sa vie, elle s’excusa sincèrement de ce qui lui avait échappé et cela ne fut pas la dernière fois que nous devions voir des soignants nous violenter, puis revenir en s’excusant. Les remarques et moqueries sont légion courantes et parler d’un patient à la troisième personne alors qu’il est présent aussi. Certains soignants vont jusqu’à « faire thérapie » avec le patient devant tout le groupe de façon totalement humiliante et irrespectueuse. « Vous devriez travailler ça ou ça en thérapie ça irait mieux, et pourquoi ça vous met dans cet état, ça vous rappelle votre mère ? » Humiliant, inapproprié voire dangereux.
Tous les patients sont en outre logés à la même enseigne dans la façon de s’adresser à eux alors que la plupart ont toutes leurs facultés mentales et que certains sont titulaires de doctorats, sont chefs d’entreprise, journalistes, avocats, etc. On nous parle comme à des handicapés mentaux légers, comme cela « on est sûr qu’ils comprennent tous ». Toute demande (passer un coup de fil, aller chercher des cigarettes,…), implique une position de soumission et d’humiliation car rien n’est acquis et peut changer selon des règles impossibles à comprendre. Pouvoir fumer n’est toléré qu’à certaines heures et certains endroits mais cela change régulièrement. La mortification passe aussi par le fait d’imposer un rythme de vie totalement étranger (et non justifié) au patient : se lever à 8 heures, se laver avant 20 heures, ne pouvoir se reposer avant telle heure, etc. Si le patient ose demander des explications ou un assouplissement, il est traité de difficile, d’insatisfait et de mal organisé. Rentrant une fois tard d’une réunion AA, nous avons voulu prendre une douche, l’infirmière s’est moquée sardoniquement en fermant devant nous la porte à clé avec un sourire en coin « Fallait y penser avant ! » Sauf que chaque infirmière ferme les douches à des heures différentes…Le fait aussi de ne même pas savoir s’habiller dans les douches est très éprouvant car il faut passer à moitié nue dehors ou trouver des stratagèmes et les remarques sur le physique sont monnaie courante également. « T’as vu la grosse ? Ferait bien de maigrir celle-là »…Les douches sont quelque chose de très important en hôpital psychiatrique du coté des soignants, ils en ont une peur panique. Un jour où une coupure d’électricité a eu lieu, toutes les infirmières se sont ruées sur les portes des douches, wc et salle de bain. Nous leur avons demandé ensuite pourquoi. « Mais enfin, vous ne voyez pas, les patients vont aller se suicider dans les douches d’office ». Nous noterons, sans nier le risque réel, qu’aucun patient à notre connaissance n’a utilisé ce moyen. Par contre nous en avons bu beaucoup tenter par médicaments, par alcool, en sautant des escaliers, des fenêtres. Mais cela n’est pas surveillé. Cependant, toute remarque de ce genre est très mal vue. Nous nous sommes plusieurs fois fait dire que nous essayions de voler le travail des infirmières en parlant aux autres patients. Avec menace de renvoi.
Une insulte revenant souvent également est le terme de « paresseux » qui ne font rien et se la coulent douce (doux euphémisme). Il est à noter qu’au départ de notre hospitalisation il nous a été interdit de participer à des activités. Ensuite il nous a été obligé de le faire. Et ensuite, nous nous sommes fait reprocher le fait d’être « trop active » et donc de nuire à notre guérison. Quoique le patient fasse, c’est mauvais pour lui. Toute décision personnelle est mauvaise puisqu’il est malade et incapable de se gérer.
Le personnel tolère également difficilement les rechutes et le prend personnellement (alors qu’il nous reproche ce défaut). Ayant subi des difficultés dans notre vie privée, nous avons un moment rechuté dans la dépression. Les remontrances ont fusé de manière très ferme : « On fait tout pour vous puis vous retombez, que voulez-vous qu’on fasse de vous, on ne sait rien faire, vous êtes une hystérique, qu’attendez-vous de nous ? On fait tout notre possible et vous rechutez, c’est insupportable ». L’alternation de soutien moral puis de réprimande est également très difficile à endurer. Si vous ne vous confiez pas aux infirmières, vous êtes un mauvais patient. Si vous vous confiez mais ne dites pas ce qu’elles veulent entendre, vous l’êtes également. Tout au long de notre hospitalisation, nous avons cherché ce qu’était pour les infirmières un « bon patient ». Force est de constater que nous n’avons jamais pu réussir à le définir. Ceux qui se remettent trop vite sont qualifiés de « menteurs » vu qu’ils se sont rétablis ou d’imbéciles qui vont devoir revenir car partis trop tôt. Ceux qui traînent sont mal vus également. La haine et le mépris envers les patients est palpable en permanence. « De toute façon, vous êtes un cas incurable, on ne peut rien faire avec vous », est une phrase revenue plusieurs fois dans notre parcours, et elle fût dite à de nombreux patients. Le seul moment où nous avons reçu une gratification est lorsque des représentants de l’hôpital se sont présentés à notre domicile pour une inspection et pour valider notre état de capacité à sortir de l’institution. Mais là encore, le mérite ne nous revenait pas, mais bien aux soins si bienfaisants qui avaient été donnés. « Vous êtes la preuve que nous soignons bien les gens, que nos thérapies et méthodes sont très bonnes, c’est beaucoup trop rare. Pourtant quand on vous a vu la première fois, on s’est dit que vous en aviez pour des années et que vous alliez devenir comme tous les autres, atteinte de chronicité des retours dans l’institution. Heureusement que vous vous êtes calmée car sinon on n’aurait rien pu faire. » Ainsi, il nous fût demandé de témoigner de la qualité des soins auprès de diverses instances. Ce que nous n’avons bien sûr pas fait. Relevons une fois encore que le simple fait que nous ayons dénoncé certaines violences à notre égard commises par le personnel est vu comme si nous nous étions énervée « pour rien » et que cet énervement était dangereux. Cette vision des émotions du patient perçues comme les signes de sa pathologie sont constantes.
Revenir au sommaire
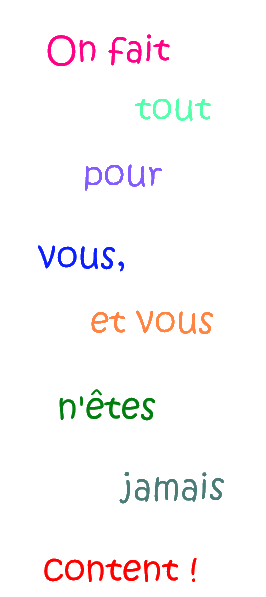


d. La contamination physique et psychique par la vie en communauté en surpopulation
Les conditions de vie des patients participent à la mortification d’eux-mêmes et de leur image de soi, par contamination physique et psychique.
La contamination physique consiste à faire perdre à l’individu tout sentiment d’intimité corporelle en plus de sa vie privée. Il n’y a ni lieu ni temps pour l’intimité. Les patients doivent vivre tous ensemble sans choix, et en mixité permanente partout. La violation du moi intime passe aussi par l’obligation de raconter notre vie ancienne et actuelle et pourquoi nous sommes hospitalisés au personnel soignant en permanence. Il faut se confesser et faire amende honorable de tous nos actes, qui seront jugés de manière impartiale par la personne qui les reçoit. Le personnel échangera ensuite en toute liberté ces informations avec qui lui semble bon, sans jamais que le patient puisse savoir ce qui se dit. Le personnel sait tout et contrôle tout, contamine toute la vie du patient. L’équipe du pavillon prend ainsi des décisions sur les plans financiers, mobiliers, affectifs, sexuels,… Les relations affectives sont découragées ou parfois encouragées, bref une position est prise. Lors des visites, aucune intimité n’est possible car la salle est commune. Les visiteurs peuvent également profiter des humiliations générales car les infirmières ne se privent pas lors des visites des proches. Le contrôle total de la vie est aussi illustré par la fameuse cellule d’isolement où « Le malade suicidaire, que sous prétexte d’assurer sa protection, on enferme nu dans une cellule éclairée en permanence et que toute personne traversant le quartier peut apercevoir par un judas. » (6) Ce qui se passe en cellule d’isolement n’est qu’un grossissement de ce qui se passe en fait partout : le contrôle totalitaire.
Le mauvais entretien des sanitaires et leur inconfort fait partie de la violence quotidienne de mortification et de contamination physique. Il faut accepter de se laver où d’autres ont déféqué, uriné, vomi, sans se plaindre. Et avec interdiction de nettoyer l’espace sale. (Ce que nous faisions tout de même par de nombreuses stratégies). Les douches ne sont pas orientables, impossible de se rincer correctement, nous attraperons plusieurs fois des infections gynécologiques graves et pareil pour les baignoires, véritables nid à germes divers. Beaucoup de patients refusent tout simplement de se laver et même d’uriner tellement ils sont traumatisés par les sanitaires, hommes et femmes. Les femmes sont cependant encore plus touchées par les soucis gynécologiques et urinaires. Nous en rencontrerons beaucoup qui souffrent de mycose, de rétention urinaire et de constipation. Il est en effet peu facile de faire ses besoins alors que se trouvent à coté des hommes en train d’uriner. Nous ne nous sentons pas en sécurité, sans compter les patients qui essaient d’ouvrir les portes, ceux qui ne savent pas les fermer et leur nudité nous est imposée régulièrement. Sur cela, nulle sanction ou représailles de la part du personnel infirmier. Le staff infirmier possède bien sûr ses propre toilettes non-mixtes et en bon état. Des infirmières nous ont confié plusieurs fois « plutôt mourir que d’aller à la toilette dans les vôtres ». Les hommes salissent souvent volontairement les sanitaires et s’en vantent, et ne les nettoient de toute façon pas, attendant que « les femmes » le fassent. Nous devons tout supporter, dans une contamination physique voulue par l’institution. Ainsi, les couverts du self aussi sont sales, mal lavés, les repas sans goût. Et il ne faut pas se plaindre sous peine de punition. Nous sommes obligés d’avaler tous nos médicaments à heures fixes (sinon nous ne pouvons manger). Pour les personnes anorexiques, elles sont forcées à manger, devant tout le monde. Pareillement pour les phobiques sociaux, ils sont obligés de descendre au self « pour leur bien ».
Le non-respect des régimes alimentaire est monnaie courante. Parfois il y a un régime diabétique, parfois non. Nous avons beaucoup souffert d’humiliations à cause de notre régime sans gluten et sans lactose. Une réelle stigmatisation s’est faite sur notre personne. Nous avons traîné ainsi l’étiquette « Exigeante-ennuyante-capricieuse-simulatrice.» Malgré des demandes répétées, il nous a été impossible d’obtenir notre nourriture à coup sûr. Nous avons, avec la médiatrice de l’hôpital, calculé que notre nourriture nous avait coûté environ 400 euros alors qu’elle est normalement comprise dans l’hospitalisation. Le personnel dans les cuisine n’est pas formé, il ne retient pas les informations et se montre très désagréable régulièrement si les patients osent manifester le moindre signe de mécontentement, pourtant bien justifié. Nous avons du manger environ 50 fois du jambon, celui-ci étant la seule denrée sans gluten sans lactose nous ayant été fournie. Stigmatisée par le personnel, nous le fûmes aussi par les patients, trop contents de trouver une distraction « T’amènes tout ça, tu ne te prives pas toi, faut toujours que tu fasses ton cinéma pour bouffer ». Ils volèrent notre nourriture à plusieurs reprises. Tout privilège étant source de plus grande liberté, il est convoité.
Pour continuer dans la contamination physique, la fouille et le contrôle régulier des lits, des chambre et des affaires (« rangez moi ce bordel et faites vos lits ») sont monnaie courante. L’intrusion dans la vie intime est constante, il n’existe aucun lieu « à soi ». Pareillement, arbitrairement on décide de vous changer de chambre, ou pas, que vous devez changer votre lit (ou pas). Le personnel ne vous prévient même pas, il dépose juste un sac rose sur le lit. Toute erreur dans le changement de literie sera source d’humiliation collective. Ainsi, un jour que nous avions tous bien changé nos lits, nous nous sommes fait tous dire par la chef de l’équipe « Alors qui n’a pas rangé sa chambre et défait son lit ? » (puis se tournant vers les autres infirmières) « Ils ont encore bourré les sacs à crever ils le font exprès pour nous emmerder. » La semaine d’après, chacun ayant bien gardé l’humiliation en tête, nous avons fait des sacs moins remplis… la réaction ne s’est pas faite attendre « Et voilà maintenant ils gaspillent des sacs et ne mettent quasi rien dedans c’est vraiment pénible.» Dans l’institution totalitaire, le jeu cruel de « pile ou face » se résume facilement : pile les patients perdent, face, les soignants gagnent. Quoique vous fassiez, c’est mal. On comprendra ainsi aisément que les patients perdent toute estime d’eux-mêmes et en leur capacité très rapidement. Ce qui, bien sûr, leur sera reproché et vu comme signe de leur pathologie.
Revenir au sommaire
 "Il faut accepter de se laver où d’autres ont déféqué, uriné, vomi, sans se plaindre. Et avec interdiction de nettoyer l’espace sale"
"Il faut accepter de se laver où d’autres ont déféqué, uriné, vomi, sans se plaindre. Et avec interdiction de nettoyer l’espace sale" "La solitude est impossible et la bonne entente entre tous les patients est obligatoire"
"La solitude est impossible et la bonne entente entre tous les patients est obligatoire"Évoquons aussi le manque d’hygiène des personnes sales qui ne se lavent pas et qu’il faut côtoyer en permanence, avec une puanteur énorme, manger à leurs côtés, supporter les regards malsains des pervers sexuels, etc. Il faut également accepter de manger de la nourriture qui a été tripotée par des gens se grattant en permanence les testicules par exemple. Les comportements de saleté corporelle et de contamination viennent surtout des hommes. Les femmes, en général, se solidarisent pour recréer des espaces plus propres et sains. Les hommes n’en ont cure et se moquent de cette « connerie féminine » en les méprisant. « Vous ne savez faire que le ménage même ici ». Le personnel infirmier est beaucoup plus tolérant envers les hommes. Ils peuvent se promener en tenues indécentes, ventre à l’air, chaussettes trouées, cheveux dégoutants en se grattant partout, alors que les femmes sont enjointes à se laver et se pomponner pour maintenir l’hygiène. Même dans cet espace de « soins » il nous fallait encore répondre aux diktats esthétiques ! Ce qui, en hôpital psychiatrique, relève souvent de l’exploit. Toutes les stratégies étaient bonnes : nous cachions du produit désinfectant dans nos affaires, nous prenions nos propres serviettes de bains, nous nettoyions les WC avant de passer, bref, nous agissions en secret pour le bien-être collectif, des hommes avant tout. La solidarité féminine permettait aussi de nous fournir du parfum ou des ustensiles de maquillage. Cette sororité nous a énormément aidée à supporter la contamination morale et physique.
Revenir au sommaire



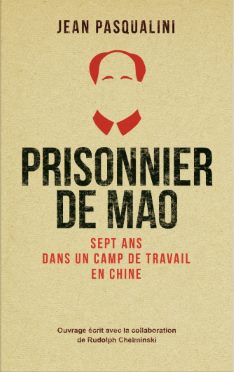

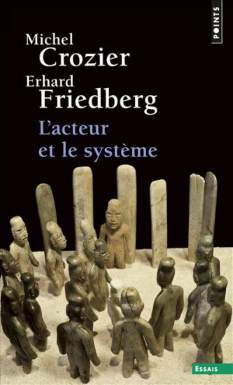 (10) CROZIER M., FRIEDBERG. E., L'Acteur et le système, Editions. du Seuil, Paris, 1981
(10) CROZIER M., FRIEDBERG. E., L'Acteur et le système, Editions. du Seuil, Paris, 1981


 "La salle de télévision, de sport ou de Snoezelen est une récompense"
"La salle de télévision, de sport ou de Snoezelen est une récompense"
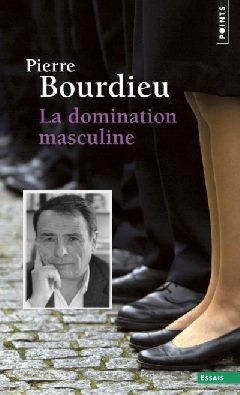

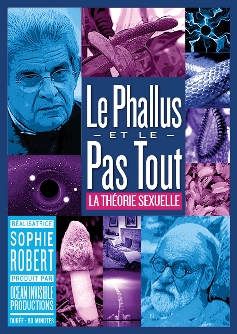 "Le discours Freudien est tellement intégré que rares sont les personnes à le remettre en question"
"Le discours Freudien est tellement intégré que rares sont les personnes à le remettre en question" (12) Nous nous référons ici au concept d’attachement traumatique tel que décrit par Muriel Salmona dans son article sur les psycho-traumatismes dus aux agressions sexuelles
(12) Nous nous référons ici au concept d’attachement traumatique tel que décrit par Muriel Salmona dans son article sur les psycho-traumatismes dus aux agressions sexuelles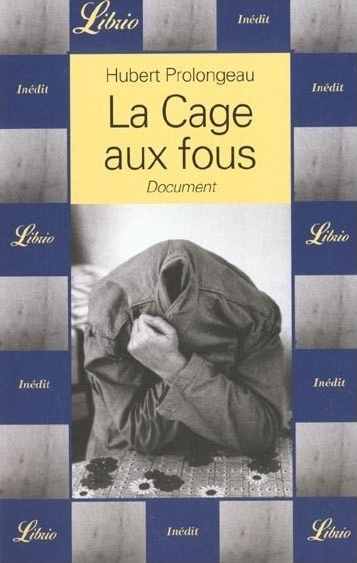 (13) PROLONGEAU Hubert, La cage aux fous, Editions Libio, Paris, 2002.
(13) PROLONGEAU Hubert, La cage aux fous, Editions Libio, Paris, 2002. "Ainsi, deux hommes du pavillon des addictions nous expliquaient leur tableau de critères pour noter les femmes… en terminant par le prix, équivalant à autant de cigarettes qu’ils seraient prêts à payer"
"Ainsi, deux hommes du pavillon des addictions nous expliquaient leur tableau de critères pour noter les femmes… en terminant par le prix, équivalant à autant de cigarettes qu’ils seraient prêts à payer"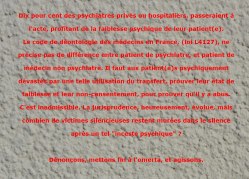 Abus sexuels en psychiatrie : en parler et agir
Abus sexuels en psychiatrie : en parler et agir

